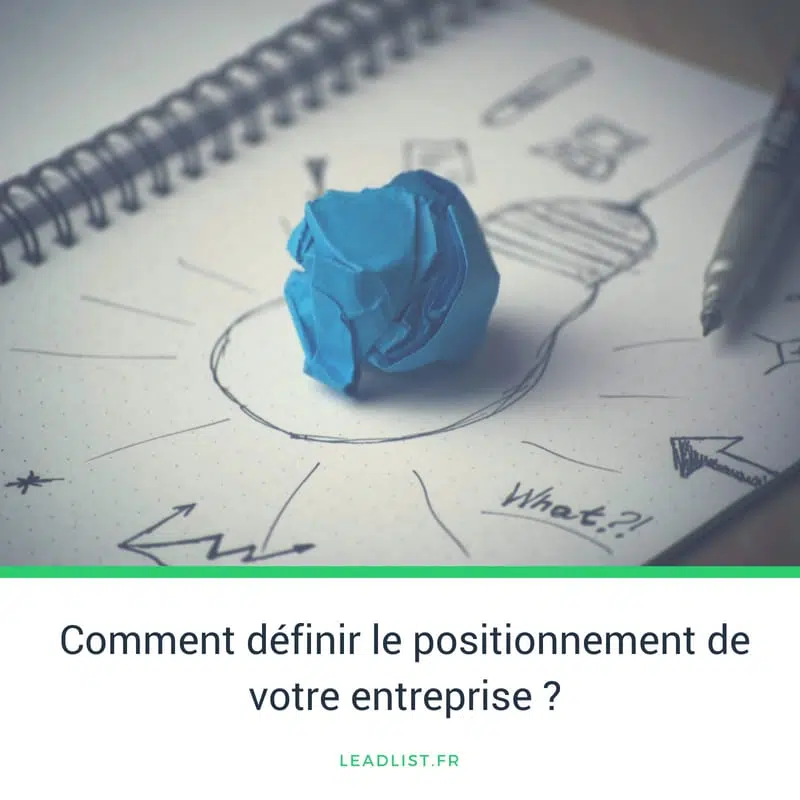Le samedi trône au cœur d’une énigme administrative qui fait trébucher bien des DRH et salariés avertis. On l’imagine naturellement inclus dans la routine hebdomadaire, pourtant son statut varie selon la règle appliquée. D’un bureau à l’autre, la frontière entre jours ouvrés et jours ouvrables se redessine, modifiant les droits, les calculs de congés et la gestion du temps de travail. Derrière ces subtilités, toute une mécanique sociale se met en branle, parfois génératrice de tensions ou de quiproquos lors des absences.
Les interprétations divergentes alimentent souvent les malentendus. Une demande de congé, un calcul de délai ou une procédure RH peuvent déraper simplement parce que le samedi n’a pas la même valeur selon la règle retenue. Ce flou attise les incompréhensions, surtout dans les secteurs à horaires atypiques ou dans les entreprises peu familières des conventions collectives. Résultat : entre ce que le code du travail prévoit et ce que chaque entreprise applique, les repères se brouillent, forçant salariés et managers à jongler avec des définitions qui impactent concrètement leur quotidien.
Jours ouvrés et jours ouvrables : deux notions à ne pas confondre
Pour comprendre ce qui distingue les jours ouvrés des jours ouvrables, il faut regarder de près comment s’organisent les semaines dans les entreprises françaises. Se tromper de catégorie, c’est risquer des erreurs de calcul qui peuvent peser lourd en cas de litige, notamment pour les absences et les droits sociaux.
- Jour ouvré : seuls les jours où l’entreprise ouvre effectivement ses portes comptent, en principe du lundi au vendredi, hors jours fériés. Certaines branches, comme le commerce ou l’hôtellerie, y ajoutent le samedi, mais c’est loin d’être la règle générale.
- Jour ouvrable : ici, on s’intéresse à tous les jours qui pourraient potentiellement être travaillés, c’est-à-dire du lundi au samedi inclus, sauf dimanche et jours fériés. Le samedi prend donc une place à part, même quand l’activité s’arrête pour le week-end.
- Jour calendaire : il s’agit de l’ensemble des jours de l’année, sans exception. Ce mode de comptage reste rare en matière de congés, mais il sert de référence dans certaines démarches bancaires ou administratives.
Voici comment chaque notion se définit concrètement :
Le dimanche s’impose comme la pause hebdomadaire, exclue des deux précédentes catégories, tout comme les jours fériés chômés, sauf mention contraire dans la convention collective. Sur l’année 2024, la France recense 252 jours ouvrés et 314 jours ouvrables : cette différence met en lumière le poids du samedi dans le calcul des droits sociaux.
Cette démarcation joue directement sur la manière dont les congés payés sont attribués. Selon le code du travail, deux systèmes coexistent : 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés pour une année complète. L’impact se ressent sur la gestion des plannings, la stratégie RH et les équilibres collectifs au sein des équipes.
Le samedi, un cas particulier : jour ouvré ou ouvrable ?
Le samedi cristallise la complexité du droit du travail français. Lorsque la règle des jours ouvrés prévaut, ce jour reste en dehors du champ : la plupart des entreprises ne l’incluent pas parmi les jours effectivement travaillés. Seuls certains secteurs, comme les grandes surfaces ou l’hôtellerie-restauration, y font exception, intégrant le samedi à leur rythme hebdomadaire.
Mais dès que l’on parle de jours ouvrables, le samedi reprend toute sa place. Peu importe que l’entreprise soit fermée ce jour-là : le code du travail compte le samedi, ce qui modifie la perception des congés. Ainsi, lorsque l’on évoque les fameux 30 jours ouvrables de congé, cinq samedis sont systématiquement englobés, même si le salarié ne travaille jamais ce jour-là. Cette règle ne souffre que de rares exceptions, dictées par des accords ou conventions qui modifient localement le mode de calcul.
Ce choix n’est pas anodin : avec 314 jours ouvrables contre 252 jours ouvrés en 2024, la différence découle directement de l’inclusion du samedi. Le mode de calcul sélectionné influe sur la gestion des congés, la planification des absences et les stratégies RH. Pour les employeurs, le choix entre jours ouvrés et ouvrables engage bien plus que le simple respect d’une norme : il structure le rapport au temps de travail et conditionne l’organisation interne.
Comment sont décomptés les congés selon le type de jours retenu
Le calcul des congés payés n’a rien d’anecdotique. Deux méthodes coexistent : l’une en jours ouvrables, l’autre en jours ouvrés. Selon la formule choisie, la gestion des départs en vacances ou des absences imprévues peut varier sensiblement.
Le code du travail donne la priorité au calcul en jours ouvrables : 2,5 jours ouvrables gagnés par mois travaillé, ce qui fait 30 jours sur une année, samedi compris. Une semaine de congé peut donc être décomptée sur six jours (du lundi au samedi, hors dimanche et jours fériés), même pour un salarié dont la présence n’est jamais requise le samedi.
- En jours ouvrables : 30 jours de congés par an, avec le samedi inclus dans le calcul.
- En jours ouvrés : 25 jours de congés par an, uniquement du lundi au vendredi.
Voici, concrètement, comment cela se traduit :
De nombreuses conventions collectives ou accords d’entreprise optent pour le décompte en jours ouvrés. Le calcul offre alors cinq semaines pleines de repos, sans ponctionner le samedi. Si le salarié tombe sur un jour férié pendant sa période d’absence, il n’est pas déduit du solde de congés si ce jour est chômé dans l’entreprise. La jurisprudence rappelle que le décompte commence toujours au premier jour ouvrable normalement travaillé.
Le mode de calcul choisi s’inscrit dans une dynamique collective : il façonne la gestion des absences, les équilibres de service et la répartition de la charge de travail, notamment lors des départs estivaux. La convention collective ou le contrat peuvent toujours prévoir des dispositions plus favorables au salarié.
Ce que cela change concrètement pour les salariés et les employeurs
La question du décompte, jours ouvrés ou jours ouvrables, n’est pas qu’une affaire de terminologie : elle pèse sur la réalité quotidienne des salariés et des employeurs. Quand le samedi est comptabilisé, une absence du lundi au lundi suivant grève six jours de congé en mode ouvrable, contre cinq en mode ouvré dans les entreprises qui n’ouvrent pas le samedi.
Pour les salariés, cette méthode influence directement le solde de congés, la préparation des absences et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Qu’il travaille à temps partiel, en télétravail ou sur une semaine de quatre jours, le salarié conserve le même nombre de jours de congés que ses collègues à temps plein. Pour l’employeur, la gestion RH s’en trouve complexifiée : le choix du paramétrage dans un logiciel de gestion des congés doit être rigoureux afin d’éviter d’éventuels litiges.
- En 2024, le calendrier national recense 252 jours ouvrés et 314 jours ouvrables. L’écart provient exclusivement de ces samedis, rarement travaillés mais souvent inclus dans les calculs.
- Le fractionnement des congés peut, dans certains cas, ouvrir droit à des jours supplémentaires, suivant ce que prévoit la convention collective applicable.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
Entre la période de référence, les jours fériés chômés, les spécificités propres à chaque secteur et la flexibilité de certaines organisations, le décompte des congés reste un exercice délicat. Il impose rigueur et vigilance pour préserver l’équité entre tous les membres de l’entreprise.
Finalement, le samedi n’a jamais aussi bien mérité son statut d’arbitre discret : selon la règle retenue, il rebat les cartes du temps libre et redessine la frontière entre travail et repos. Voilà de quoi méditer, la prochaine fois qu’un calendrier RH vous semblera anodin.