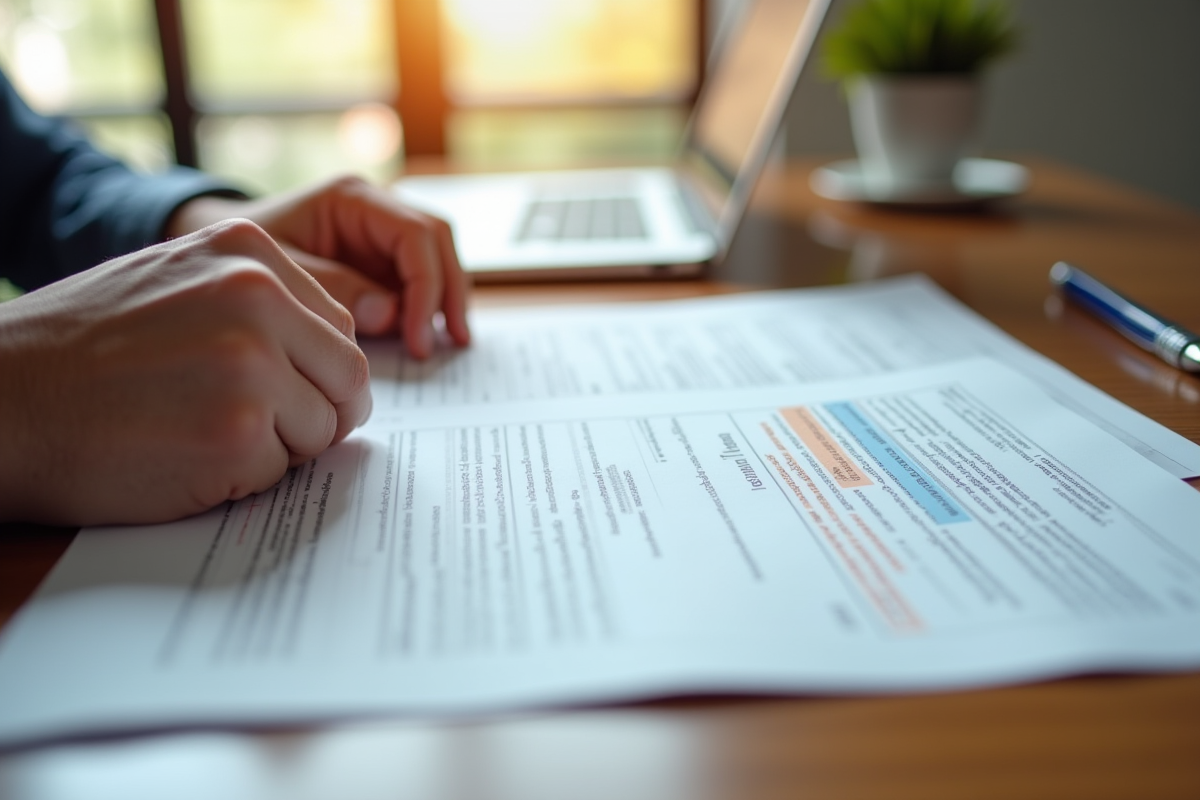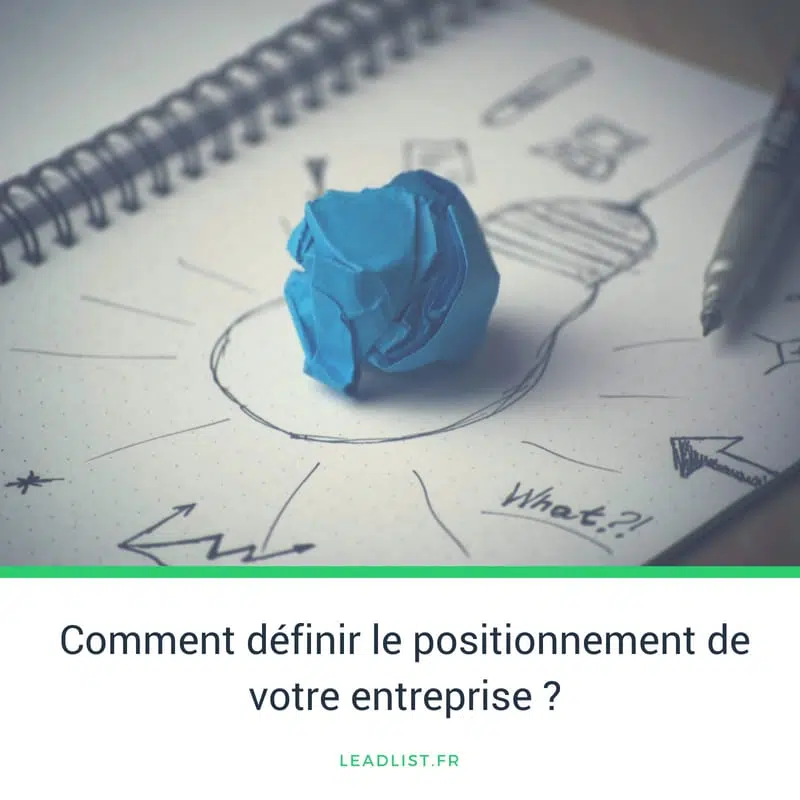Près de 600 000 salariés relèvent chaque année d’un dispositif normatif dont les classifications et les grilles salariales sont régulièrement contestées lors des négociations de branche. Des différences notables subsistent entre les statuts d’établissements publics et privés, notamment sur la reconnaissance de l’ancienneté et les modalités d’évaluation professionnelle.
La révision des accords en 2019 a entraîné une évolution des garanties collectives, tout en maintenant des disparités sur la gestion du temps de travail et l’accès à la formation. Les réformes successives n’ont pas complètement levé les incertitudes sur l’articulation entre droits individuels et exigences budgétaires des structures gestionnaires.
La convention collective 66 : origines, objectifs et secteurs concernés
Impossible de dissocier le secteur social et médico-social de la convention collective 66. Née en mars 1966, cette convention collective nationale a posé les fondations du travail dans les établissements et services accueillant des personnes inadaptées ou handicapées. Elle s’est rapidement imposée comme le cadre central dans la relation entre employeurs associatifs et salariés, bien avant que l’expression “secteur social et médico-social” ne s’invite dans toutes les discussions professionnelles.
Son ambition d’origine est limpide : installer un socle de droits pour les professionnels au contact des publics fragiles, au sein d’une mosaïque d’établissements : instituts médico-éducatifs, services d’accompagnement, établissements spécialisés… Les signataires, suivis de près par des acteurs engagés comme Nexem et les syndicats représentatifs, ont cherché à apporter stabilité, homogénéité des pratiques et reconnaissance salariale à des métiers exigeants et souvent méconnus.
Voici les types de structures concernées aujourd’hui par la ccn 66 :
- les établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées,
- les structures menant des activités sociales et médico-sociales à but non lucratif,
- plus globalement, les associations et fondations employant du personnel éducatif, administratif ou technique dans ce périmètre.
La convention collective 66 balise la gestion des droits et devoirs, l’organisation du temps de travail, la classification des emplois, la représentation du personnel avec le CSE. Elle structure le dialogue entre employeur et salarié. Mais elle doit aussi, non sans débats, intégrer la transformation progressive des métiers et l’apparition de nouveaux modèles économiques dans le secteur.
Quels sont les principaux avantages pour les employeurs et les salariés ?
La convention collective 66 a permis d’établir des garanties concrètes, aussi bien pour les employeurs que pour chaque salarié, qu’il s’agisse d’un cadre ou d’un non-cadre. Premier point fort : la fameuse grille de salaires. Grâce à ce système, les rémunérations minimales sont clairement établies, évoluant en fonction du coefficient hiérarchique et de la valeur du point. Ce fonctionnement protège l’équité, réduit les écarts et simplifie la gestion des parcours professionnels dans les établissements et services du secteur.
Autre pilier : la prime de sujétion spéciale, qui compense, par exemple, les contraintes liées au travail de nuit ou l’accompagnement de publics spécifiques. Les congés payés, congés trimestriels et congés exceptionnels en cas d’événements familiaux font partie des protections les plus appréciées. Si un salarié tombe malade ou part en congé maternité, la convention prévoit le maintien du salaire sous conditions d’ancienneté, avec des règles plus favorables que le code du travail. L’accès à une mutuelle et à des services sociaux participe à la sécurisation des parcours.
Du côté des employeurs, la convention collective 66 offre un cadre stable et lisible. Les classifications de postes, les procédures de gestion des absences, les dispositifs de formation professionnelle : tout cela facilite grandement la gestion RH. Se référer au texte permet d’éviter bien des contentieux et de piloter un budget RH avec moins d’incertitude, puisque les obligations (du 13ème mois aux différentes primes) sont balisées. Cette stabilité nourrit le dialogue social et entretient la confiance au sein des équipes.
Limites et points de vigilance à connaître avant application
La convention collective 66 montre aussi ses limites. Sa grille de salaires, conçue pour la sécurité, peut freiner la valorisation de certaines compétences rares, alors que la concurrence entre établissements s’intensifie. Pour les employeurs, la gestion du 13ème mois ou de certains congés spécifiques, comme les congés trimestriels, peut alourdir la masse salariale, sans nécessairement répondre à tous les besoins opérationnels.
Le personnel handicapé adulte rencontre encore des obstacles : l’accès aux congés trimestriels reste limité, ce qui nourrit des tensions internes. Sur le plan juridique, l’articulation entre convention collective nationale et code du travail ne va pas de soi. Certaines règles conventionnelles, plus avantageuses que la loi, obligent à une vigilance accrue lors des départs ou du calcul des indemnités.
Voici quelques points concrets à surveiller lors de l’application de la convention :
- La rupture du contrat de travail : les procédures sont spécifiques, avec parfois des délais de préavis supérieurs à ceux du code du travail.
- L’exclusion de certains avantages selon les statuts, notamment en matière de congés.
Ce cadre protecteur a son prix : il exige des directions et des salariés une connaissance approfondie de ses règles et une capacité d’adaptation constante. Les mutations du secteur social et médico-social, les réformes du dialogue social, l’arrivée de nouveaux acteurs invitent à remettre régulièrement sur la table l’équilibre trouvé il y a plus de cinquante ans.
Quel impact concret pour la gestion RH au quotidien ?
Travailler en RH sous convention collective 66 revient à jongler avec des exigences pointues. La grille de salaires, le calcul des primes, la gestion des congés : autant de sujets qui réclament une attention continue, sous peine de se perdre dans la complexité des règles. Le dialogue social prend une place à part, avec la présence active des syndicats et du CSE. Chaque modification, chaque accord local, chaque évolution sectorielle impose une réaction rapide et une vigilance juridique de tous les instants.
La gestion des absences, qu’il s’agisse d’un arrêt maladie, d’un congé maternité ou d’un congé pour recherche d’emploi, nécessite une lecture détaillée des droits spécifiques, souvent supérieurs aux minima légaux. Les équipes RH doivent aussi composer avec des délais de préavis allongés, ou des modalités de rupture du contrat de travail qui sortent du schéma classique. Les recrutements exigent dès le départ une maîtrise parfaite du classement hiérarchique et de la valeur du point, pour garantir une équité réelle et limiter les contestations.
Quelques pratiques incontournables s’imposent pour sécuriser la gestion RH :
- Un suivi individuel rigoureux des droits acquis
- Une formation continue, indispensable pour bien maîtriser la convention collective
- Des échanges soutenus avec les partenaires sociaux
La formation professionnelle, pilier de la convention collective, s’ancre durablement dans les priorités RH. L’organisation du temps de travail, la construction des plannings, la reconnaissance de l’ancienneté deviennent des leviers de fidélisation, mais aussi de complexité administrative. Les gestionnaires RH du secteur sont attendus au tournant : transformer ces contraintes réglementaires en atouts pour attirer et fidéliser les talents, voilà le véritable défi.