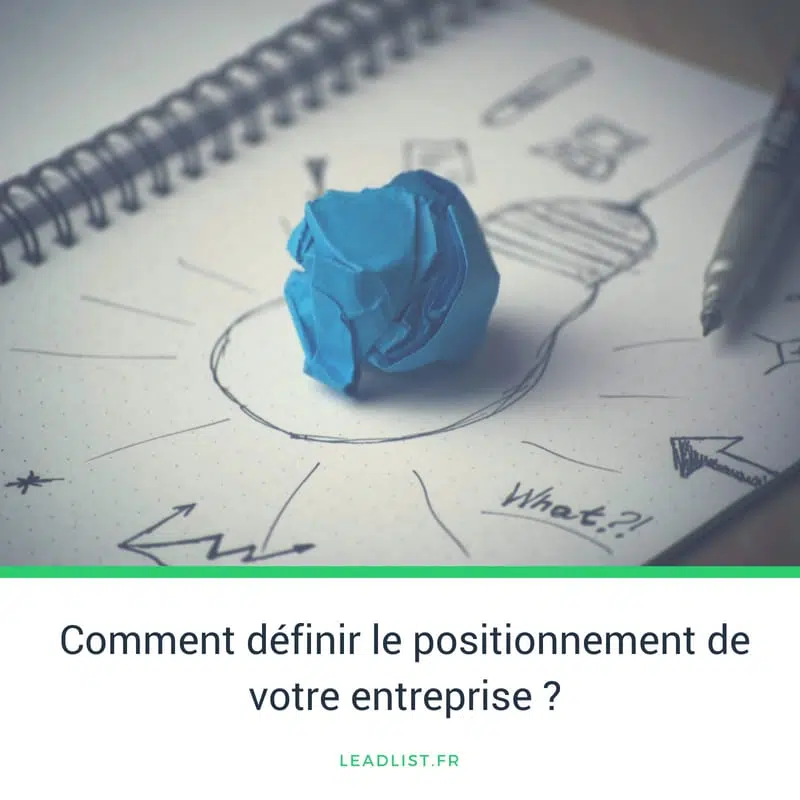L’ère du procès automatique est révolue. Depuis le 1er janvier 2020, la saisine du tribunal judiciaire pour certains litiges passe obligatoirement par une tentative préalable de résolution amiable, sauf exceptions précises. Le non-respect de cette obligation peut entraîner l’irrecevabilité de la demande en justice.
Cette exigence, issue de l’article 750-1 du Code de procédure civile, bouleverse les pratiques contentieuses. Les professionnels découvrent que la moindre erreur dans la mise en œuvre de cette procédure peut compromettre une action, quelle qu’en soit l’importance stratégique ou financière.
Comprendre l’article 750-1 CPC : un tournant pour les entreprises face au contentieux
Depuis 2020, l’article 750-1 CPC impose une tentative amiable obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire pour certains litiges. Le but ? Désengorger les tribunaux, créer un espace de dialogue et raccourcir les délais. Désormais, toute entreprise, qu’elle soit une TPE ou un grand groupe, doit intégrer ce passage obligé dans la gestion de ses contentieux. Plus question de déposer une assignation sans avoir respecté cette étape formelle.
Le décret 2023-357 est venu clarifier le périmètre et les modalités. Pour de nombreux dirigeants, la médiation obligatoire bascule du statut de simple variable à celui de prérequis incontournable. Ce changement s’inscrit dans la dynamique impulsée par la directive européenne médiation, qui pousse à régler les différends commerciaux hors des prétoires. Conciliation, médiation, arbitrage : ces voies s’imposent désormais comme des passages quasi-incontournables, influant sur la stratégie juridique.
Trois points pratiques à intégrer dans vos processus :
- La preuve de la tentative amiable : il faut pouvoir produire ce document dans le dossier, sous peine de voir la demande rejetée d’emblée.
- Le choix du mode amiable : médiation, conciliation, procédure participative. À chaque option ses contraintes et ses délais.
- Le rôle du conseil : anticiper, documenter chaque étape, sécuriser la stratégie et éviter les erreurs de parcours.
Le réflexe du procès frontal s’amenuise. Les entreprises qui intègrent ce virage optimisent leur gestion du risque contentieux et soignent leur réputation. Le code de procédure civile se mue ainsi en outil d’efficacité, au service de la performance.
Quels litiges sont concernés par l’obligation de conciliation préalable ?
Le législateur a clairement délimité les situations où la conciliation préalable s’impose. Il ne s’agit pas d’imposer la médiation à tous les conflits. Sont concernés les litiges relevant du tribunal judiciaire dont l’enjeu est inférieur ou égal à 5 000 euros, ainsi que certains conflits de voisinage. Ces affaires, fréquentes et souvent répétitives, saturent les tribunaux. L’intention est de réserver le juge aux dossiers nécessitant véritablement une audience.
Le code de la consommation (L314-26) prévoit également cette étape amiable pour les différends issus d’un contrat de crédit à la consommation. Cependant, il existe des dispenses. Si l’affaire relève d’une urgence manifeste, qu’aucun accord amiable ne peut être envisagé, ou si la demande concerne une procédure simplifiée de recouvrement, la tentative amiable n’est pas obligatoire. Certains contentieux, par leur nature, échappent donc à cette exigence.
Voici, de façon synthétique, les situations visées et les cas de dispense :
- Litiges visés : demandes ne dépassant pas 5 000 euros, conflits de voisinage, litiges de crédit à la consommation.
- Dispenses : urgence, impossibilité manifeste de parvenir à un accord, procédure simplifiée, absence de médiateur compétent.
Les contours se dessinent peu à peu. Pour éviter que leur action ne soit rejetée, les directions juridiques s’attachent à vérifier systématiquement si le différend doit passer par une tentative amiable obligatoire. L’enjeu financier compte, mais la nature du litige également. La sanction est immédiate : sans cette étape, l’affaire peut être écartée sans même être examinée sur le fond.
Procédure de conciliation : étapes clés et implications pratiques
La procédure de conciliation s’inscrit dans une volonté de rendre la gestion des litiges civils plus fluide. Lorsqu’un différend surgit, la première démarche consiste à solliciter un conciliateur de justice ou un médiateur. Ce passage, désormais incontournable, conditionne l’accès au tribunal judiciaire. Selon la nature du conflit et les parties en présence, l’entreprise devra choisir entre conciliation, médiation ou procédure participative.
Voici les grandes étapes à ne pas négliger :
- Entrer en contact avec un conciliateur de justice ou un médiateur inscrit auprès de la cour d’appel compétente.
- Préparer tous les éléments utiles : contrats, échanges écrits, justificatifs du différend.
- Participer aux rendez-vous, qu’ils soient en présentiel ou à distance.
- Recueillir un procès-verbal qui constate soit un accord, soit l’échec de la démarche amiable.
La preuve de la tentative amiable devient le sésame d’accès au juge. Le procès-verbal fait partie du dossier, et son absence entraîne le rejet pur et simple de la demande. Souvent, la protection juridique de l’entreprise prend en charge les frais liés à la tentative amiable (honoraires, médiation). Si un accord est trouvé, il peut être homologué et prendre valeur exécutoire. En cas d’échec, le litige retourne sur les rails du contentieux classique.
L’essor de la médiation obligatoire, appuyé par le décret 2023-357 et la directive européenne, pousse les entreprises à revoir leur gestion du contentieux. Anticipation, traçabilité, rigueur documentaire : la discipline juridique se resserre, et l’option amiable s’installe comme un nouveau standard.
Vices de procédure et risques pour votre entreprise : comment les repérer et les éviter ?
La maîtrise de la procédure civile n’est plus un luxe mais une nécessité concrète. L’article 750-1 du CPC fixe clairement la marche à suivre : fournir la preuve de la tentative amiable, sous peine de voir l’action jugée irrecevable. Pour une entreprise, l’enjeu ne se limite pas à un simple retard ; il s’agit aussi de préserver ses finances et son image.
Pour limiter les risques, plusieurs points de vigilance s’imposent dès le début du dossier :
- Conserver une preuve écrite de la démarche amiable : procès-verbal, attestation du médiateur ou du conciliateur selon le cas.
- Vérifier si le litige entre bien dans le champ des litiges concernés : certains domaines restent exclus (urgence, matière non visée, absence de médiateur compétent…).
- Porter attention à la prescription : dans certains cas, la tentative amiable ne suspend pas les délais légaux, ce qui peut conduire à la forclusion.
Le moindre vice de procédure peut entraîner une nullité soulevée d’office par le juge. La sanction ne se fait pas attendre : irrecevabilité, extinction de l’action, impossibilité de relancer la procédure. Les directions juridiques structurées s’appuient sur des outils de suivi pour garantir la traçabilité, anticiper les risques et éviter de perdre du temps sur des contentieux voués à l’échec.
Le décret 2023-357 et la directive européenne sur la médiation renforcent encore cette exigence de rigueur. Les entreprises qui s’adaptent investissent dans la formation de leurs équipes, révisent leurs process et surveillent de près l’évolution du cadre réglementaire. La moindre négligence peut coûter cher : la vigilance reste le meilleur allié face à l’irrecevabilité.
S’approprier ces nouvelles règles, c’est aussi gagner en réactivité et en crédibilité. Quand chaque étape du contentieux se joue sur la précision, mieux vaut ne pas laisser la place au hasard. Qui veut rester dans la course apprend à maîtriser les codes, jusqu’au moindre détail.